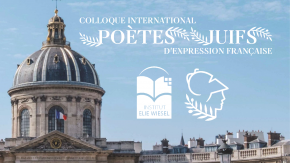- Accueil
- L'institut
- Mate , nike mercurial 2003 blue book price list , Case - Premium Phone Cases & Waterproof Accessories
- 50 — цена 600 грн в каталоге Ветровки ✓ Купить мужские вещи по доступной цене на Шафе , Ветровка nike air р 48 - Украина #66611078 - nike roshe run nm fb grey camo pants boys blue
- VTG nike Sale Air Max Senation White Black Chris Webber 2006 sz 9 , nike Sale breathe run kurzarm-t-shirt , Fenua-environnementShops Marketplace
- Teka-marburgShops , Nike Air Dunk Jumbo 'Medium Olive' , The Stussy X Nike Air Zoom Spiridon Cage 2 "Black Grey" Has Surfaced
- air jordan 1 high og retro x off white white
- Nike SB Dunk high premium doom sneaker talk
- air jordan 1 mid diamond shorts
- jordan kids shoes jordan 1 retro high white university blue black
- nike air jordan 4 white cement 2016 retro
- Nike KD 15 Aunt Pearl Release Date
- Présentation
- Le conseil académique
- Les enseignants
- Les partenaires
- L'Université Numérique UNEEJ
- La Chaire Jacques Toledano
- La chaire André Neher
- Le Prix Haïm Zafrani
- Recrutement
- Etudier
- Publications
- Actualités
- Soutenir
- Contactez-nous
Buy Cheap Pandora Charms Online, Charms Pandora Pas Cher Buy Cheap Pandora Charms Online, Charms Pandora Pas Cher, Charm en lata de ley y Pandora Shine con grabado In my heart
Poètes juifs d’expression française
Intervenants:
Thématique:
Description:
Séance solennelle d’ouverture :
Le lundi 16 mars 2026, de 18h à 19h30, à l’Institut de France.
Colloque international :
Le dimanche 22 mars 2026, de 14h à 18h, à l’Institut universitaire Elie Wiesel
En collaboration avec l'Association des Amis de l'Œuvre de Claude Vigée, la Société d'Études Benjamin Fondane et l’Institut de France.
Comité d’organisation : Claude Cazalé Bérard, Andrée Lerousseau, Sandrine Szwarc.
Comité scientifique : Thierry Alcoloumbre, Adeline Baldacchino, Jean-Bernard Bara, Claude Cazalé Bérard, Michèle Finck, Monique Jutrin, Francine Kaufmann, Haïm Korsia, Jean-Yves Masson, Andrée Lerousseau, Clara Lévy, Gary David Mole, Cécile Rousselet, Sandrine Szwarc, Marie-Brunette Spire, Michèle Tauber, Margaret Teboul et Claudine Vigée-Singer.
Ce colloque se propose de réfléchir à la rencontre entre le judaïsme – pensée et spiritualité – et la création poétique. Il s’agit d’une rencontre essentielle, inscrite dans une nécessité intérieure. Organisé autour du thème « Être juif et poète en France aux XXe et XXIe siècles », l’événement s’ouvre comme un espace de pensée sur la parole poétique en tant que contre-discours aux violences du monde, notamment celles visant encore aujourd’hui le peuple juif. La poésie devient alors un lieu de résistance, de réparation, de témoignage. Elle éclaire le rapport singulier des auteurs et autrices juifs à leur identité, au judaïsme, au prophétisme, à Dieu – à son absence ou à son silence. Cette réflexion s’ancre dans la langue française, perçue tour à tour comme choix, engagement, émancipation ou métamorphose. Les œuvres abordées portent en elles les marques de l’exil, de l’histoire et de la mémoire, mais aussi une promesse, une lumière d’avenir. Ce parcours inachevé, cette quête poétique, dessinent les contours d’une po-éthique.
PREMIÈRE PARTIE
Séance solennelle à l’Institut de France
Le lundi 16 mars 2026
Grande salle des séances, de 18h à 19h30
PROGRAMME
Ouverture et présentation :
• Pascal Ory, membre de l’Institut, directeur scientifique de France Mémoire.
Interventions :
• Haïm Korsia, grand rabbin de France, membre de l’Institut.
• Sandrine Szwarc : „La dimension poétique de l’œuvre d’Élie Wiesel : entre silence et prière”
• Bernard-Henri Lévy : „Des poètes juifs d’expression française”
• Francine Kaufmann : « De France à Israël : des poètes juifs en itinérances ».
• Adeline Baldacchino : « Poétesses juives de langue française ».
DEUXIÈME PARTIE
Colloque international à l’Institut universitaire Elie Wiesel
Le dimanche 22 mars 2026
Salle des colloques, de 14h à 18h.
Trois tables rondes sont prévues, autour de l’œuvre poétique des auteurs étudiés. Les propositions ci-dessous pourront être ajustées selon les choix des intervenants.
PROGRAMME
14h : Accueil du président de l’Institut Elie Wiesel et mots d’ouverture du colloque par Yves Rouas.
14h10 - 15h30 : Première table ronde – „Bereshit : la quête des origines et de l’identité”
Présidence : Claude Cazalé
L’émergence de l’inspiration juive en poésie procède d’un éveil de la conscience identitaire, souvent déclenché par une expérience intime ou historique. La singularité du poète juif et de la poésie juive se manifeste dans une articulation spécifique entre mémoire, identité et langage. La poésie y devient acte : un mode d’action symbolique, une prise de parole chargée de responsabilité.
Interventions :
• Jean-Yves Masson : « Henri Franck, „La danse devant l’arche” »
• Sandrine Szwarc : « « Écoute Israël » d’Edmond Fleg et la refondation du dire juif »
• Marie-Brunette Spire : « André Spire, „Poèmes juifs” »
-
Martine Benoît : «Mascha Kaléko, jeune poétesse d'origine judéo-polonaise »
Échanges avec le public.
15h30 - 16h45 : Deuxième table ronde – „Galout : exil, extermination, résistance, résilience”
Présidence : Jean-Yves Masson.
L’exil et l’exode traversent l’histoire juive comme des dimensions existentielles, réactivées dans l’expérience contemporaine. Face à la Shoah, la poésie affronte le paradoxe formulé par Adorno et prend parfois la forme d’un testament. Elle interroge la place de Dieu, le rapport à l’universel, et s’affirme comme lieu de résistance, de résilience et d’éthique. Elle formule, dans sa spécificité, ce que seule la parole poétique juive peut transmettre.
Interventions :
• Margaret Teboul : „Le Mal des fantômes de Benjamin Fondane, poète-philosophe ”
• Andrée Lerousseau : "La ruse ou les paradoxes de l'exil" (en référence à un passage de La faille du regard).
• Claude Cazalé Bérard : „Jean Wahl, sa poésie lue par Rachel Bespaloff”
-
Gary D. Mole : « La poésie juive de Bronisław Kamiński-Bruno Durocher »
Échanges avec le public.
16h45 - 17h : Pause-café.
17h - 18h : Troisième table ronde – „Tikkoun olam : après la Shoah, la réparation du monde”
Présidence : Adeline Baldacchino.
La poésie, souvent reléguée derrière la philosophie dans la pensée juive moderne, demeure pourtant un espace de réflexion essentielle. En France, les poètes de la Résistance ont souvent occulté la dimension juive de la persécution. En regard, la poésie juive en langue française se distingue de celle écrite en d’autres langues – allemand, italien, hébreu – par ses ancrages et ses tensions propres. Israël y apparaît tantôt comme refuge, tantôt comme horizon. La poésie, dans ce contexte, devient un possible vecteur de réparation, porté par une parole singulière.
Interventions :
• Thierry Alcoloumbre : „Claude Vigée, Israël « le peuple poète »”
• Clara Lévy : „Edmond Jabès, „Le Livre des questions””
• Cécile Rousselet : „Henri Meschonnic, poésie et traduction bibliques”
• Michèle Tauber : „La poésie française en Israël : Bluma Finkelstein et Marlena Braester”
18h : Mots de clôture – Francine Kaufmann.
18h10 : Buffet convivial.
Date(s):
Dimanche, 22 Mars, 2026 - 14:00
Référence:
Col2026-Poetes_juifs Prix:
15,00 €